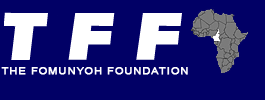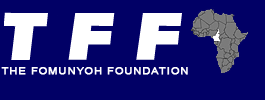Christopher Fomunyoh "L'opposition doit faire son autocritique"
Le 6 Septembre, 2013
Le politologue camerounais, directeur régional du National Democratic Institute, explique pourquoi aucun parti ne parvient à s'imposer face au RDPC au pouvoir.
 Christopher Fomunyoh supervise des programmes de soutien à la démocratie.
Christopher Fomunyoh supervise des programmes de soutien à la démocratie.
© Vincent Fournier pour J.A.
Fils de planteurs de la région du Nord-Ouest, Christopher Fomunyoh a quitté Yaoundé en 1988 pour entrer à Harvard. En 1992, il rejoint le National Democratic Institute, à Washington, think-tank démocrate dont il est désormais le directeur pour l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale. À 57 ans, il partage son temps entre les États-Unis et les capitales africaines, où il supervise des programmes de soutien à la démocratie.
Jeune Afrique : L'opposition est-elle aussi inconsistante qu'on le dit ?
Christopher Fomunyoh: Elle se distingue surtout par son émiettement. Le Cameroun compte plus de 250 partis pour plus de 20 millions d'habitants. Par ailleurs, comme dans beaucoup de pays où la transition démocratique est difficile, elle évolue dans un environnement qui ne favorise pas son épanouissement. La fusion de facto entre le parti majoritaire et l'État complique la percée des mouvements d'opposition, qui n'ont pas accès à des ressources humaines et matérielles aussi importantes.
Comment en est-on arrivé là?
Les conditions du retour au multipartisme ont joué un rôle clé. Dans les années 1990, de nombreuses formations ont été créées en vue d'une conférence nationale. Hélas, le régime Biya n'a pas choisi cette formule. Mais les partis sont restés. Certains se sont morcelés, d'autres ont vu le jour - parfois avec la complicité du pouvoir, ravi de fragiliser un peu plus l'opposition.
Aucune classe dirigeante n'a jamais admis la nécessité de contre-pouvoirs...
C'est exact, la culture du multipartisme, la conquête d'espaces de liberté et l'acceptation de l'alternance ne sont jamais parvenues à s'imposer. Dans les années 1950 déjà, l'Union des populations du Cameroun a connu bien des déboires en tentant d'incarner une opposition véritable. Au lendemain de l'indépendance, entre 1961 et 1966, les leaders politiques ont subi des pressions pour que toutes les formations se fondent dans le parti unique, l'Union nationale camerounaise. Et comment oublier les violences et les militants tués lors de la création du Social Democratic Front, en 1990 ? Que l'opposition éprouve des difficultés ne surprend pas : le pays est géré par des personnalités qui ont fait toute leur carrière sous le régime du parti unique.
Faut-il pour autant désespérer?
Pas du tout. Les dinosaures des partis uniques ou des régimes militaires d'hier s'éteignent. Ces vingt dernières années, plus d'une trentaine de pays africains ont connu une alternance. Le Cameroun ne restera pas en marge de ce mouvement. Ne serait-ce que si on considère sa démographie : les 5 % de Camerounais (ou moins) qui prennent en otage 95 % de leurs compatriotes ont 75 ans et plus...
Selon vous, qu'est-ce qui pourrait ranimer l'opposition et la rendre crédible ?
Pour être efficace, elle doit faire son autocritique. Elle doit aussi renouveler son leadership pour ne pas reproduire les erreurs qu'elle reproche au parti au pouvoir. Le Cameroun n'a pas besoin d'un RDPC bis [Rassemblement démocratique du peuple camerounais]. Il faut qu'elle combine ses efforts avec ceux de la société civile : syndicats, universitaires, médias, associations, etc. Elle pourrait s'inspirer du Sénégal. Un pays où la démocratie aurait été étouffée en 2011-2012 s'il n'y avait pas eu un sursaut collectif, grâce à l'émergence d'une coalition efficace de partis d'opposition appuyée par la société civile.
Quel est le regard des États-Unis ?
Le Washington officiel n'a pas d'autre choix que de traiter avec le régime élu. Mais l'autre Washington, lui, apparaît perplexe face à un pays aux potentialités énormes et qui, pourtant, en matière de démocratie et de gouvernance, ne parvient pas à servir de locomotive au continent tant sa trajectoire politique est floue et sa gestion des espaces de liberté ambiguë.
© Jeune Afrique
|